J'ai souhaité, dans ce rapport annuel, alerter en particulier sur l'ampleur et l'augmentation des discriminations en France, confirmées par de nombreuses études. la diminution paradoxale des réclamations que nous avons reçues cette année dans ce domaine met en lumière la difficulté des victimes à faire valoir leurs droits, et la nécessité de s'emparer collectivement de cette problématique.
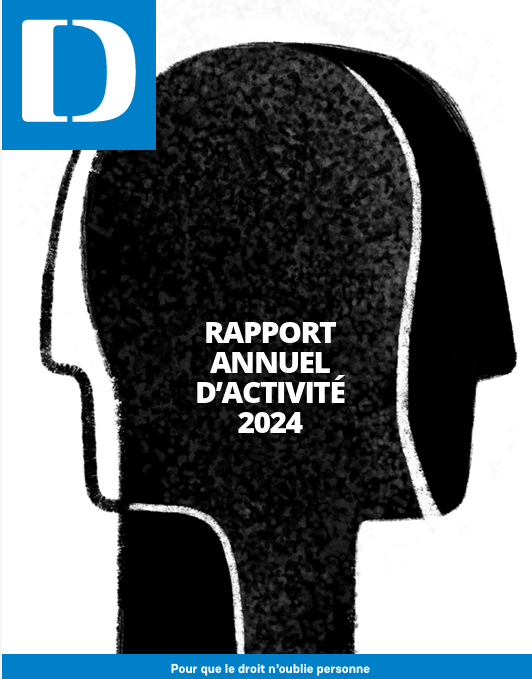
Manque de cohérence et de visibilité
Les politiques publiques se réduisent souvent à des actions ponctuelles et sectorielles, dirigées vers certains critères de discrimination, selon les priorités du moment.
Parce qu'elle vise à garantir les conditions indispensables à la cohésion de la societé, la LCD doit être l'une des priorités de l'action de l'Etat. celle-ci doit engager les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs dans une démarche visant à interroger les pratiques afin d'assécher à leur source les discriminations.
-
Un non-recours massif, dans un contexte d'augmentation préoccupante des discriminations en France
De nombreuses enquêtes démontrent que cette augmentation concerne en particlier les discriminations liées à l'origine et à la religion. L'origine arrive en tête des appels téléphoniques reçus sur sa plateforme 3928. La part des réclamations liées à l'origine constitue le deuxiéme critère invoqué par des réclamants après le handicap. L'institution constate d'ailleurs, dans son baromètre 2024 sur la perception des discriminations dans l'emploi notamment, un glissement du motif de l'origine vers celui de la religion en raison d'une focalisation accrue autour des questions religieuses dans les rapports sociaux. Ces augmentations peuvent s'expliquer par un contexte économique qui accroie la compétition pour l'accès à des ressources limitées, un contexte de polarisation des opinions, nourri par certains discours politiques et médiatiques. Le faible nombre d'affaires portées devant les juridictions et la baisse des réclamations reçues en matière de discrimination en 2024 (-15%) confirment l'a^mpleur du non-recours.
-
Retablir les personnes dans leurs droits et accompagner le changement de pratiques
Au delà du travail conséquent mené par les services du DDD pour accroître le traitement individuel des réclamations et retablir leurs droits, le caractère systémique des discriminations necessite, au delà des réponses individuelles, le déploiement d'une stratégie d'ensemble pour corriger les mécanismes de production. Le colloque organisé en février 2024 en témoigne et rappelle 8 recommandations essentielles :
- Mesurer les discriminations pour agir
- Permettre aux juges de prendre des sanctions dissuasives
- Assurer une réelle portée à l'action de groupe
- Assurer un engagement des organisations dans la prévention des discriminations
- Obtenir des procédures de signalements éfficaces et des sanctions disciplinaires au sein des organisations
- Lutter contre les discriminations produites par les algorithmes et l'IA
- Assurer la transparence, la traçabilité et l'objectivation des procédures et décisions
- Lutter contre les contrôles d'identité discriminatoires
Retrouvez le rapport annuel 2024 complet ici
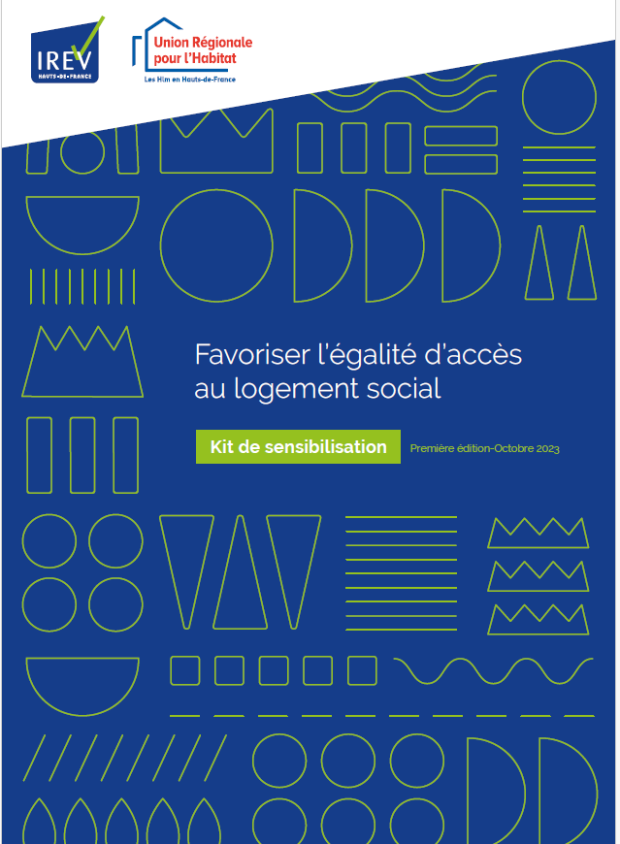
L'IREV pleinement mobilisé pour accompagner le changement des pratiques :
De la région au national : une formation pour favoriser l'égalité d'accès au logement social
Grâce au soutien de l'USH et de l'ANCT, cette démarche continue d'être essaimée à l’échelle nationale. L'IREV, centre de ressources pour la politique de la ville en partenariat avec l'Union Régionale pour l'Habitat Hauts-de-France, franchissait ainsi en janvier et mars deux étapes importantes en partageant son kit pédagogique et son module de sensibilisation avec notamment les Centres de Ressources Politique de la Ville et les Unions Régionales pour l'Habitat.
Après une expérimentation régionale riche en enseignements, ce travail, construit avec des bailleurs, collectivités et des représentants de locataires, s'étend désormais pour répondre aux enjeux d'égalité et de non-discrimination dans l'ensemble des territoires.
Ce que propose ce kit pédagogique :
Le kit de sensibilisation permet de dispenser un premier module de 3H30 dédié à la maîtrise des fondamentaux. Ouvert à tous les acteurs en charge des attributions (bailleurs, collectivités, Etat et représentants des locataires), il permet de comprendre le cadre législatif, la sémantique en matière de discrimination ainsi que sa traduction possible à travers des situations concrètes. Le kit de sensibilisation constitue le principal support et permet de revenir sur les principaux apports.
Le second kit pédagogique du référent permet d’organiser une session d’une journée permettant de devenir « référent ». Ce module, optionnel, permet d’identifier des personnes « ressources » capables de diffuser le module de sensibilisation auprès d’autres collaborateurs et/ou d’être une personne « ressource ». Cette démarche permet de constituer des binômes de référents sur chaque territoire. Le kit pédagogique du « référent » ainsi que son support diaporama constituent les principaux supports permettant à ces binômes de réaliser cet objectif.
-
Un support diaporama commenté pour accompagner les formations.
Les objectifs :
- Interroger les pratiques,
- Limiter le risque discriminatoire.
Pourquoi cette démarche est essentielle ?
Parce que l'égalité d'accès au logement social n'est pas qu'une ambition, c'est une exigence légale et éthique.
En formant les professionnels, en partageant des outils concrets et en créant un espace de réflexion, cette initiative contribue à renforcer des pratiques professionnelles justes et inclusives.
L'ensemble des supports sont en accès libre, un article à ce sujet est à paraître dans le prochain Hors série des Cahiers de la LCD.
Aujourd'hui, cette démarche prend une nouvelle dimension, en s'adressant à des territoires partout en France grâce à nos homologues CRPV et aux unions régionales pour l'habitat. Une opportunité pour multiplier les impacts positifs au service de l'intérêt général.
Vous êtes intéressé(e) ? Découvrez nos outils et rejoignez cette mobilisation !
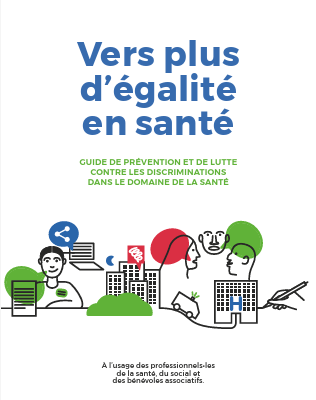
Prochain temps fort de l'IREV : Vers plus d'égalité en santé
Discrimination en santé : besoin d'être outillé ?
Le droit à la santé est un droit fondamental reconnu à tout être humain. Le secteur de la santé s’appuie sur une déontologie forte. Parler de discriminations peut susciter des malentendus et un certain malaise.
Pourtant, diverses situations interrogent les professionnels-les de la santé, du social et du médicosocial : refus de rendez-vous à des bénéficiaires de la CMU-C ou de l’AME, différences de traitement non justifiées, refus de déplacement de services médicaux dans certains quartiers, stigmatisation de certains publics, etc. Les causes sont variées, allant des représentations stéréotypées aux facteurs plus systémiques (organisation des soins, formation des professionnels-les…).
L'IREV, centre de ressources de la politique de la ville des Hauts-de-France s'est déjà appuyé sur l'association MSA pilote d'une démarche de qualification à travers son guide "Vers plus d'égalité en santé". A partir d'un travail actualisé, l'IREV propose un temps court permettant de présenter la démarche, le guide et son contenu ainsi que les perspectives de qualification associées.
Prendre connaissance du guide actualisé
Fruit d’une réflexion de longue date, Migrations Santé Alsace a publié, en avril 2019, un guide de prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé que l'association a réactualisé.
Pourquoi ce guide ?
Ce guide est pensé pour soutenir les professionnels-les et les bénévoles de la santé et du social dans leurs réflexions sur l’accueil de la diversité des publics, l’adaptation et la qualité de la prise en charge, le respect des principes déontologiques et la lutte contre les inégalités sociales de santé.
Admettre l’existence de discriminations peut être difficile pour les professionnels-les et bénévoles. Cela revient à reconnaître que des pratiques puissent être contraires à la déontologie et à l’éthique professionnelles voire illégales.
Une discrimination peut être définie comme une différence de traitement, sur la base d’un critère illégal et portant préjudice à la personne. Elle est encadrée par le droit.
De fait, cette notion reste peu mobilisée dans le domaine de la santé.
Pourtant, elle est riche à explorer car :
– elle prend en compte une variété de situations, certaines évidentes et d’autres plus diffuses (refus de rendez-vous non justifié, baisse de qualité de prise en charge, retard aux soins, propos stigmatisants,…) ;
– elle invite à sortir du silence et à échanger autour de situations du quotidien qui peuvent questionner ;
– elle permet de s’interroger sur l’impact des représentations, stéréotypes et préjugés dans l’accompagnement et dans la prise en charge ;
– elle propose un cadre juridique pour guider les pratiques ;
– elle permet d’analyser la manière dont le système de santé reproduit certaines inégalités sociales et ainsi d’identifier des leviers pour les réduire ;
– elle offre des pistes concrètes pour réfléchir aux modalités d’accès aux soins et à la santé de tous-tes.
Quels sont les objectifs ?
- · sensibiliser aux discriminations vécues par les usagers-ères dans le domaine de la santé ;
- · apporter des éléments d’analyse ;
- · outiller les professionnels-les prévenir et lutter contre les discriminations dans leurs pratiques au quotidien.
Une journée dédiée :
L'IREV propose une journée de qualification permettant d'aller plus loin c'est à dire de mieux maîtriser son contenu, d'échanger sur des cas pratiques, d'identifier les leviers mobilisables sur vos territoires.
Cette journée se déroulera en présentiel le :
Mardi 13 mai 2025
9H30-16H30
Centre de documentation de l'IREV
135 Blvd Painlevé 59000 Lille
S'inscrire à la journée
Plus d'informations, contactez-nous :
La loi de programmation pour la ville du 21 février 2014 a certes ajouté le critère du lieu de résidence, mais sans pour autant susciter des projets locaux ambitieux. Certaines collectivités parviennent cependant, par l’engagement d’acteurs locaux impliqués, à mettre en place des stratégies transversales et structurantes. [...] Une impulsion nationale, relayée par les services de l’État, paraît indispensable pour encourager les territoires plus hésitants à s’engager résolument dans cette belle lutte pour le vivre ensemble, avec des moyens humains et financiers à la hauteur de l’enjeu.