
Le programme cités éducatives
Co-piloté par les Ministères de l'Education nationale et en charge de la ville, le programme national des cités éducatives est coordonné par l’ANCT et la DGESCO depuis son lancement en 2019. Expérimenté initialement dans de grands quartiers prioritaires concernés par le renouvellement urbain et des enjeux de mixité scolaire, la labellisation s'est progressivement étendue et est désormais accessible, depuis 2024, à tous les territoires en Politique de la ville. Plus de 200 cités éducatives existent aujourd’hui sur tout le territoire français, couvrant 500 quartiers prioritaires, dont une trentaine en région Hauts-de-France, et certains territoires sont en cours de labellisation. Rappelons que les cités éducatives constituent un programme global de développement des logiques de coopération entre les acteurs et de renforcement de la communauté éducative autour des enfants et des jeunes. Elles visent à accentuer l’accompagnement socio-éducatif des jeunes des QPV de 0 à 25 ans.
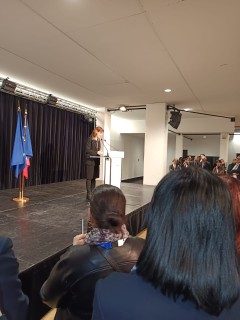
Une rencontre fédératrice et riche
Comme chaque année l'ANCT et la DGESCO organise une rencontre nationale à Paris. L'occasion cette année de réunir les acteurs des cités éducatives au forum national avec l'ambition de favoriser la diffusion d’outils et de ressources, de partager des expériences et de permettre l'échange entre pairs. Un programme qualitatif, diversifié et dynamique qui offrait aux acteurs quel que soit leur "rôle" et leur degré de maturité des ressources fiables, des retours d'expériences mais également des espaces d'échanges et de débats. L'approche thématique a permis de nourrir des enjeux forts relatifs aux mobilités spatiales, à la promotion de la santé, aux ruptures de parcours...Le rôle du chef de projet opérationnel, pierre angulaire de ces cités n'a pas non plus était oublié.
Les centres de ressources politique de la ville étaient nombreux, mobilisés aux côtés de la coordination nationale pour faciliter ou animer des séquences de ce temps fort au sein de l'espace "Agora".
Du temps de l'expérimentation à celui de l'évaluation
Parmi les temps forts de cette journée, l'évaluation tenait une place particulière. En effet, face aux constats dressés par l'INJEP en 2023, qui soulignent notamment l’absence de vision homogène de la démarche et certaines difficultés rencontrées par les acteurs locaux, la proposition d’élaborer un socle référentiel se veut une réponse stratégique pour renforcer la coordination des efforts à l’échelle locale comme nationale. Cette journée a notamment proposé un atelier dédié au référentiel d'évaluation. Qu'il s'agisse de cités éducatives labélisées en 2019 ou celles émergentes, la définition des enjeux stratégiques doit s'accompagner d'une démarche qualitative sur les critères d'évaluation et indicateurs de suivi retenus. Un enjeu complexe identifié par les porteurs du programme national qui proposait un atelier dédié avec la présentation en avant-première du cadre référentiel national travaillé notamment avec les acteurs locaux et des centres de ressources politique de la ville.
Ce cadre opérationnel en attente de publication officielle se veut structurant. Il invite à soutenir 4 enjeux forts de ce programme :
- Renforcer la coordination et réduire les disparités territoriales,
- Soutenir l'innovation locale et créer des dynamiques,
- Garantir la continuité et la professionnalisation des acteurs,
- Institutionnaliser et évaluer les écarts.
Les méthodes proposées rassemblent plusieurs volets :
- Observatoire
- Transverse
- Actions
L'IREV sera pleinement mobilisé pour le diffuser et accompagner les cités éducatives des Hauts-de-France à s'interroger, à se l'approprier.
Un discours ministériel soutenant
Juliette Méadel, récemment nommée Ministre chargée de la ville a effectué sa première intervention publique officielle. Dans son discours, elle a pu saluer le travail des professionnels de l'éducation, de la jeunesse et de la Politique de la ville. Elle a également rappelé l'importance d'investir dans l'éducation et l'avenir des jeunes, notamment ceux les plus fragilisés. L'ambition portée tout au long de cette journée rejoint les mots forts de la Ministre à savoir "Soutenir pour émanciper". A ce titre, elle a affirmé s'inscrire dans une démarche de défense des budgets du programme Cités éducatives et de la Politique de la ville dans sa globalité.
Une démarche continue et réflexive qui s'inscrit dans le temps
La table ronde conclusive, à laquelle participait notamment François Flahaut, Secrétaire général adjoint à la cohésion sociale de la préfecture du Pas-de-Calais, a permis de réaffirmer quelques ingrédients incontournables pour pleinement tirer profit de ce label et ancrer ses acquis dans la durée :
- prendre le temps, au sein de la troïka qui pilote la cité éducative, de l'acculturation réciproque, y compris entre services de l'Etat (Préfecture / Education nationale) ;
- tirer pleinement profit de la capacité d'adaptation aux priorités du territoire du programme ;
- prendre appui sur les acquis des contrats de ville pour dépasser les difficultés actuelles de mobilisation des parents et des jeunes...
Les échanges ont montré que ce programme ambitieux est traversé par les mêmes interrogations et recherche d'équilibre que d'autres programmes et dispositifs de la politique de la ville.
Ainsi faut-il privilégier l'investissement dans l'ingénierie et financer des manières de travailler ensemble par la qualification, la transformation des pratiques professionnelles des communautés d'acteurs ? Ou, au contraire, prioriser le soutien à une programmation d'actions qui parfois tend au "catalogue" ?
La réorientation des crédits demandée par la coordination nationale vers les moyens d'ingénierie tend à soutenir cette recherche d'équilibre. Un exercice évidemment difficile qui reste parfois mal vécu dans les territoires mais pourrait être gage de transformation durable des situations et d'évolution des politiques publiques.
